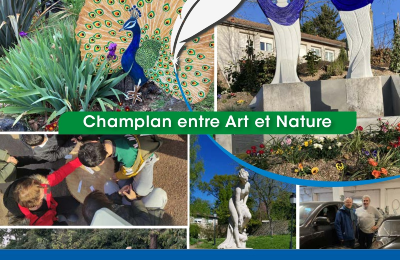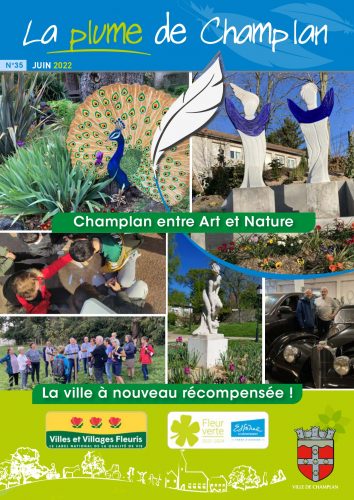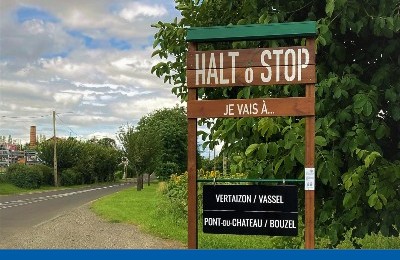À l’occasion, le 4 juin 2022, de la venue des élus de la commune belge de Souvret pour un échange culturel, Massérac, en Loire-Atlantique, a inauguré son four à pain communal.
Les travaux, réalisés par l’association des Fours de Massérac, ont duré un peu plus d’un an.
Selon, Fabrice Sanchez, maire de Massérac, cette réalisation vise à créer du lien entre les habitants et s’inscrit dans une volonté de faire du centre du village un lieu vivant.
La commune de Massérac s’est lancée en 2020 dans un projet de construction d’un four à pain communal.
« Il est totalement neuf. Il n’y avait pas de fours dans les environs et nous avions envie de lancer ce projet pour plusieurs raisons », explique Fabrice Sanchez.
La première est, selon lui, de recréer du lien entre les habitants et de créer de la vie dans la commune.
« Le four se trouve à côté de la salle polyvalente du village. Nous avons aussi aménagé une galerie commerçante avec quatre emplacements à côté du four afin de faire venir des commerces ambulants. Enfin, nous avons déplacé la mairie dans l’ancien presbytère situé à côté lui aussi. Cela permet d’avoir une concentration de ces espaces de convivialité au sein du village », détaille Fabrice Sanchez.
Un four à l’ancienne
La commune a pu compter sur la générosité des habitants pour réaliser le projet. Les matériaux utilisés sont uniquement tirés d’un processus de recyclage. Le granite est par exemple issu d’anciens ponts de chemins de fer à l’abandon.
La construction a été réalisée avec l’aide d’une association locale, les Fours de Massérac. Grâce aux 20 bénévoles, les travaux ont été réalisés à la main avec l’accompagnement d’un tailleur de pierre. Au total, la commune a dépensé, à ses seuls frais, 10 000€ dans le projet.
L’utilisation du four
Utiliser un four à pain demande une certaine expertise. « Les personnes qui souhaitent s’en servir doivent d’abord suivre une formation auprès de l’association, elles reçoivent ensuite un diplôme qui certifie cette maitrise », détaille Fabrice Sanchez. Les travaux ont duré plus d’un an et ont été rallongés en raison du Covid qui empêchait les rassemblements dans la rue.
Les associations de la commune peuvent utiliser le four gratuitement. Les personnes qui louent la salle polyvalente peuvent-elles aussi s’en servir. Chacun peut donc profiter de ce four qui sert aussi bien à faire des pizzas que du pain. « Pour célébrer les 150 ans de l’Église de la commune nous avons organisé une fête et le four a beaucoup servi », confie Fabrice Sanchez. « Les habitants sont très satisfaits. Désormais nous avons même pour projet de construire un fournil pour mettre le four à l’abri des intempéries », conclut le maire de Massérac.
POUR ALLER PLUS LOIN :
> Facebook du Four de Massérac
Fabrice Sanchez
Maire de Massérac« Pour faire d’un projet de four communal un succès il me paraît essentiel de s’entourer d’une association et de bénévoles expérimentés. C’est utile car ils permettent d’apporter une expertise précieuse et parce que cela permet de réduire les coûts de ce qui serait autrement trop onéreux pour une commune rurale. »