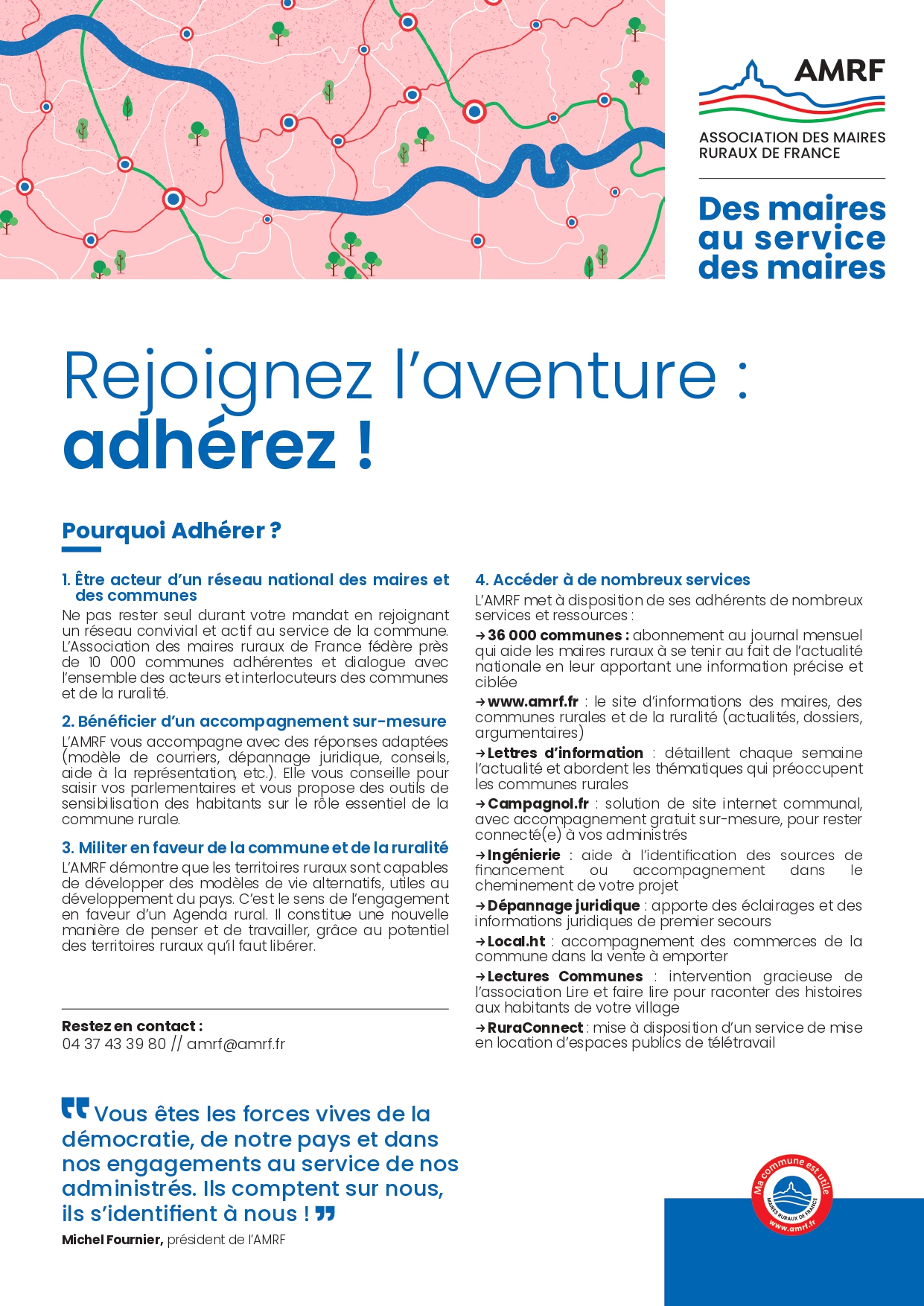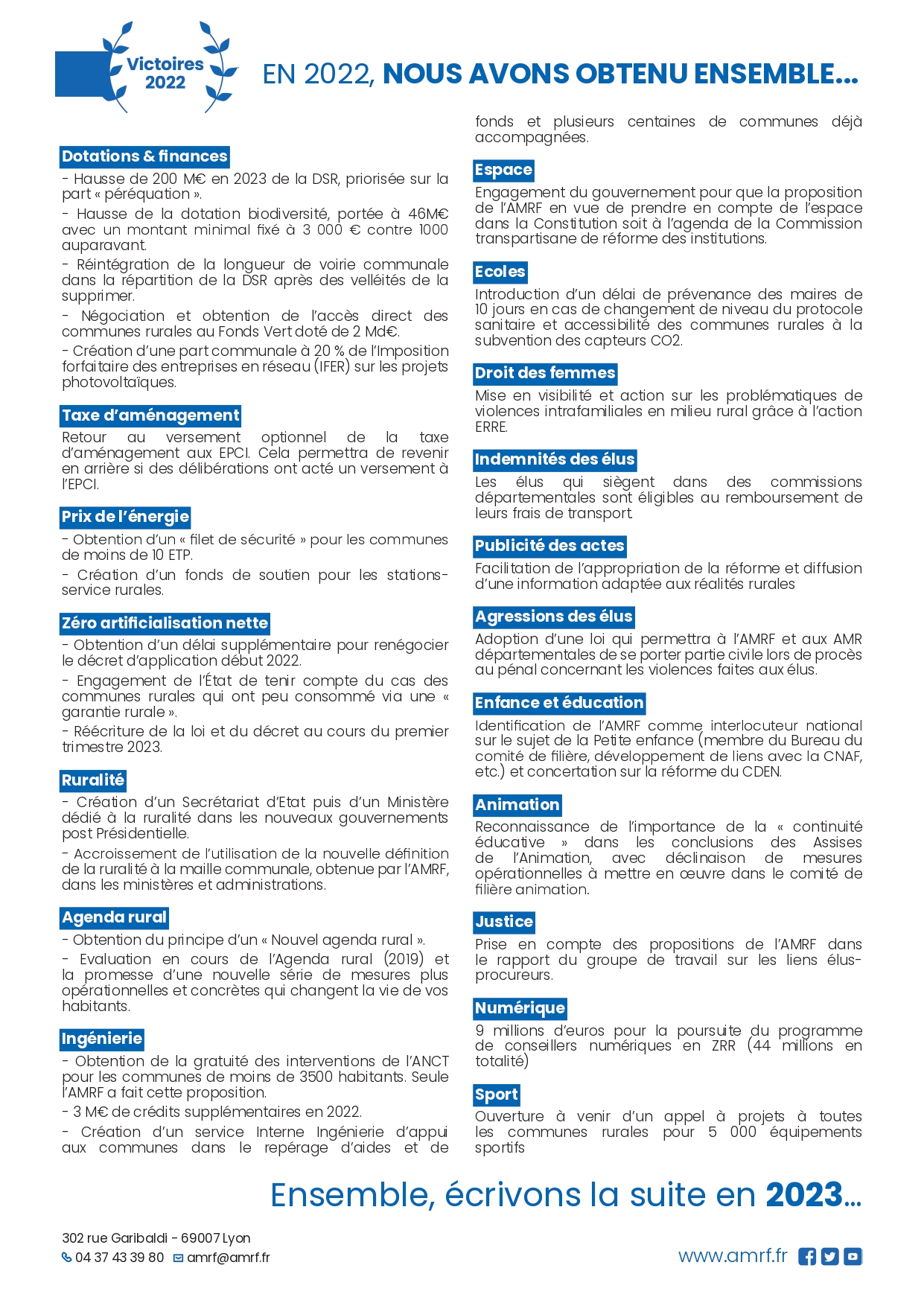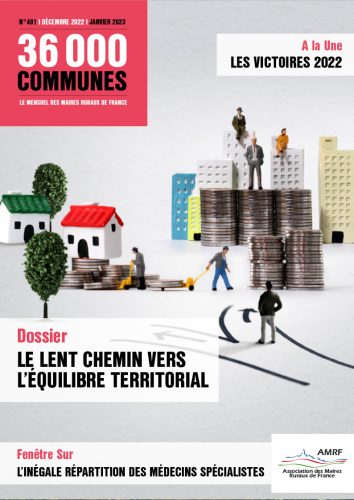LE JOURNAL DES MAIRES RURAUX
Mensuel de 24 pages, 36 000 Communes entend aider les maires ruraux à se tenir informés de l’actualité nationale en leur apportant une information précise et ciblée. Fidèle aux valeurs d’indépendance de l’AMRF, ce journal porte un regard critique sur l’actualité. Il a vocation à donner aux maires ruraux les outils pour influer sur les décisions qui concernent la ruralité.
Le journal est aussi un lieu d’échanges, rendant compte des actions menées par les maires ruraux dans leur commune ou dans leurs associations départementales. Tiré à plus de 15 000 exemplaires, il est adressé aux adhérents de l’AMRF ainsi qu’à tous les parlementaires, les Conseils généraux et les Conseils régionaux.
N°402 – Ils sont fous ces élus ?

ÉDITO
Michel Fournier,
président de l’AMRF
En 2022, dans notre Europe, une Nation se fait bombarder au quotidien avec toutes les conséquences d’approvisionnement en nourriture, chauffage, énergie, … sans oublier les victimes de cette agression.
Dans d’autres pays, comme l’Iran ou l’Afghanistan, au nom d’une interprétation délirante d’une religion, on impose une société d’enfermements et plus encore pour les femmes.
Ailleurs encore, des dictateurs décident, seuls, de l’avenir de leur pays contre toute notion d’humanité et font fi du « vivre en paix » que peuvent souhaiter leur population.
En 2022, dans notre France, la démocratie a parlé, enfin, seulement une petite moitié d’électeurs s’est exprimé et c’est regrettable !
Résultat, une Assemblée Nationale divisée derrière ou contre un Président affaibli.
Il nous faut faire avec cette représentation qui fait une belle démonstration du vivre ensemble !
Pour les plus anciens, c’est soit « les jeux du cirque » soit au mieux « la piste aux étoiles ».
Souvent, la seule ambition est de faire le buzz au petit bonheur des médias et des réseaux sociaux ….
Alors, si tous les responsables politiques et syndicaux ne prennent pas conscience de la réalité du quotidien de chacun d’entre nous sur les problématiques de santé, de mobilité, d’économie, d’écologie, d’énergie…. et j’en passe, l’année 2023 sera certainement agitée pour ne pas dire compliquée !
Il sera difficile, dans ces conditions, de faire avancer les choses, y compris pour notre RURALITE qui a besoin d’être mieux reconnue. Je continuerai personnellement à me battre au plus haut niveau de l’État pour cela, avec toute l’équipe AMRF. Mais n’oublions pas que chacun d’entre vous avez aussi votre rôle à jouer, c’est de notre responsabilité collective !
Alors ensemble, faisons pousser nos idées dans nos Villages d’Avenir !

Consultez quelques extraits :
> L’urgence d’un véritable statut de l’élu